
En 2008, James Reason, professeur d’université britannique et sans doute l’un des plus grands spécialistes de la sécurité aérienne, publiait un nouvel ouvrage : The Human Contribution, dont le sous-titre était : Acts, Accidents and Heroic Recoveries. Il y présentait des exemples marquants, souvent célèbres, où des hommes s’étaient sortis de situations a priori désespérées. Rappelons-en quelques-uns :
-
Sioux City : l’équipage d’un DC-10 réussit un atterrissage sans commandes de vol, à la suite de l’explosion d’un moteur, sauvant ainsi les deux tiers des passagers. Si ce scénario n’était pas prévu, l’équipage s’y était malgré tout préparé. Cet exploit fut réédité vingt ans plus tard par l’équipage d’un Airbus cargo à Bagdad, touché par un tir de missile.
-
Bagdad 2003 : un Airbus A300 cargo de DHL est touché par un missile sol-air peu après son décollage. L’explosion détruit les circuits hydrauliques et prive l’équipage de toutes les commandes de vol. En utilisant uniquement la poussée différentielle des moteurs, les trois membres d’équipage parviennent à ramener l’avion et réussissent un atterrissage d’urgence à Bagdad, sauvant ainsi leur vie et l’appareil.
Il y en a bien d’autres, dans les domaines les plus variés, où l’intervention humaine a été décisive pour éviter ou limiter la catastrophe.
Qu’avaient en commun tous ces « héros » — militaires, astronautes, aviateurs ? James Reason s’interroge et identifie ce qui les rassemble :
-
Un optimisme raisonnable, c’est-à-dire le contraire du désespoir. Ils allaient jusqu’au bout de l’action, quoi qu’il arrive.
-
Un bon équilibre entre le neuf et l’ancien : d’un côté la connaissance, l’entraînement et l’expérience, de l’autre des improvisations inspirées. Chaque cas étant différent, c’est l’équilibre qui compte.
-
Ils étaient, pour conclure, à chaque fois la bonne personne au bon endroit ; en quelque sorte, ils avaient the right stuff — l’étoffe des héros.
James Reason estime qu’il y a plus de potentialités dans l’étude de ces situations hors normes pour améliorer la sécurité des opérations à risque que dans les approches classiques. Car nous savons déjà beaucoup sur « l’individu dangereux », responsable des erreurs qu’il commet, mais bien moins sur « l’individu héroïque », qui parvient à se sortir de situations complexes et imprévisibles. Il souligne toutefois qu’il ne faut pas surestimer ce modèle de l’opérateur héroïque, car la sécurité globale d’un système repose avant tout sur un équilibre optimal entre vigilance individuelle et vigilance collective.
Cependant, ce livre nous rappelle qu’il nous faut nous préparer à être, malgré nous, les « héros » de demain. Alors :
-
Ne renonçons jamais : accrochons-nous, quelles que soient les circonstances.
-
Ayons confiance en nous : notre formation nous y prépare.
-
Cherchons à nous améliorer chaque jour un peu plus.
-
Restons ouverts au changement.
-
Soyons prêts à réagir face à l’imprévisible.
-
Essayons, modestement, d’être exemplaires.
C’est sans doute cela, l’étoffe des héros.
Bons vols



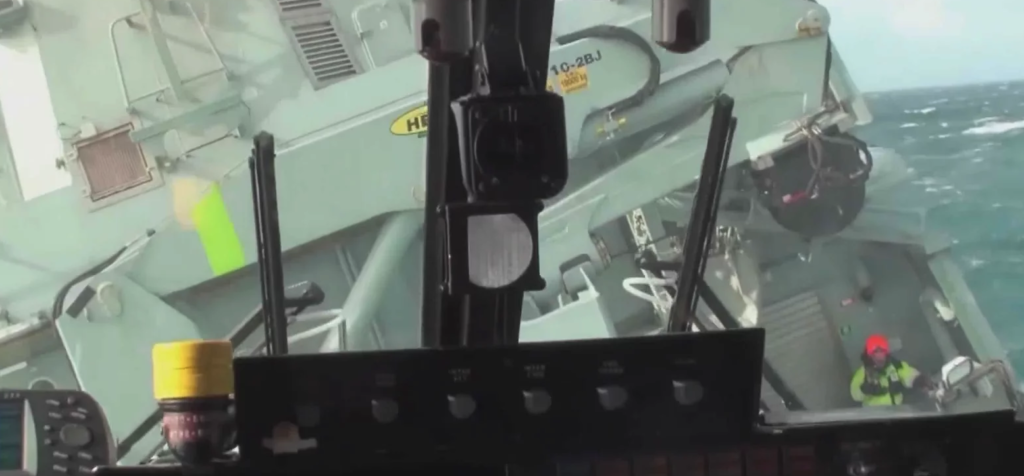
La présence d’un individu dans un cockpit, un équipage ou dans une structure aéronautique doit être à l’image des termes utilisés par ce grand chercheur qu’est Reason : la vigilance collective doit servir de garde fou pour aider un acteur à travailler et s’épanouir.
Seul, celui-ci ne peut se positionner ou obtenir des “limtes à ses actions”.
A l’inverse, seulement intéressé par le groupe et sa structure, l’individu ne vit pas les situations assez loin et est arrêté dans ses actions par les autres membres.
Les qualités propres de chacun doivent participer à l’accroissement du niveau d’une entité collective… encore faut il avoir la matière (heures de vol, cours, échanges, simulateurs) pour améliorer les compétences.
L’épreuve dévoile la réalité des êtres. Mais au delà des qualités propres des “héros”, leur utilité est peut être expliquée par ces “cellules miroir”, découvertes par une équipe italienne de physiologie dans notre encéphale. Si j’ai bien compris, elles permettraient de “vibrer” en fonction de nos perceptions, de nos sens, et de nous donner une mémoire, un apprentissage, par “empathie”, (ou peut-être par “sympathie”, à la manière des cordes libres d’une viole d’amour). Cela expliquerait que, sans avoir vécu une scène, notre comportement s’est adapté à cette situation comme s’il l’avait vécue. Cela expliquerait notre attrait morbide (et naturel) pour les accidents, et sans doute notre attrait pour les héros…
Vivent les débriefings !
Vélivolement vôtre.