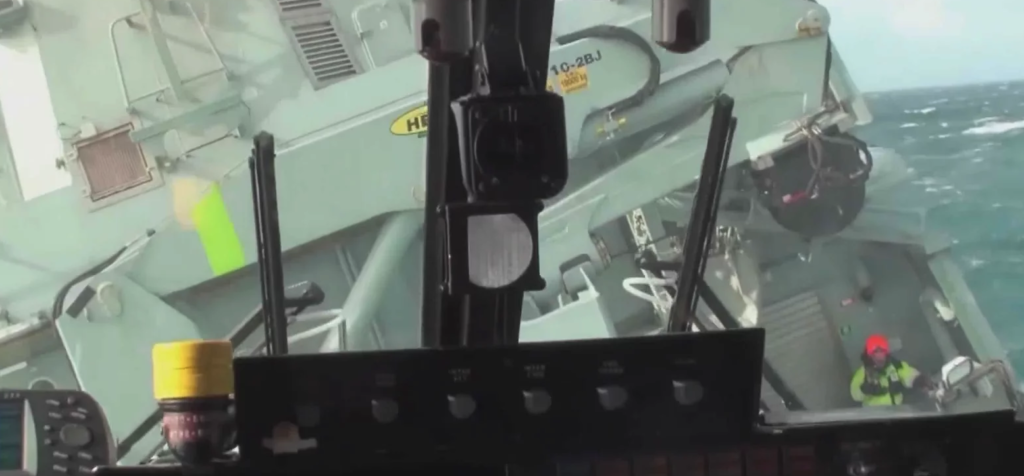Voici le deuxième article de Benjamin Pelletier qui est formateur en management interculturel, chargé de cours aux Mines Paristech et écrivain. Il anime également le site internet Gestion des Risques Interculturels.
Vous pouvez cliquer ici pour accéder à son premier article.
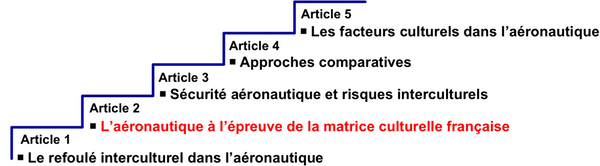
La mission d’information de 2004
Le 3 janvier 2004, le crash du Boeing 737 de la compagnie égyptienne Flash Airlines a causé la mort de 148 personnes (dont 135 touristes français) au large de Charm el-Cheikh. Suite à cette catastrophe, une mission parlementaire a été mise en place pour faire l’état des lieux sur la sécurité des voyageurs dans le transport aérien. La députée Odile Saugues a présidé cette mission d’information qui a rendu son rapport (pdf) le 7 juillet 2004.
Durant plusieurs mois, les principaux acteurs du transport aérien ont été auditionnés par les députés. Les minutes des auditions sont disponibles ici (pdf). Ce document de 455 pages mérite d’être lu attentivement pour avoir une vue d’ensemble des questionnements liés à la sécurité du transport aérien, tout en ayant conscience que cette vue d’ensemble reste limitée par la dimension hautement institutionnelle de ces auditions et l’inévitable langue de bois de certains intervenants.
Le présent article propose une lecture de ce document faite par un non-spécialiste de l’aéronautique qui s’efforce d’élargir le radar de l’analyse pour repérer les facteurs culturels qui impactent un domaine d’activité spécifique. Les auditions de 2004 permettent ainsi de mettre en évidence les défis que le secteur aérien doit relever au sein de la matrice culturelle française. Les enjeux liés à la sécurité restent la priorité de cette nécessaire prise de conscience de nos propres freins et obstacles culturels à surmonter pour établir une culture commune de la sécurité.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des auditions ainsi que des commentaires et informations complémentaires. Dans un souci de clarté et de concision, les citations qui illustrent cette synthèse sont données sans mention du nom et de la fonction de leurs auteurs. Ces précisions se retrouvent facilement en consultant les minutes des auditions de la mission parlementaire.
Un rapport complexé à l’erreur
L’erreur peut-elle être comprise positivement ? Cette question sous-tend nombre de discussions autour de la question du signalement des incidents fait par le personnel à la hiérarchie. Positivement ne signifie pas ici que l’on valorise le fait de faire une erreur mais que l’on valorise le contenu cognitif de l’erreur. L’erreur permet d’apprendre sur soi, sur les autres, sur le processus et le système dans lesquels elle s’insère. La culture du débriefing des erreurs est essentielle dans une perspective de culture de sécurité. Ce débriefing n’est possible que sous deux conditions majeures :
1. L’erreur doit être communiquée.
Cette évidence se heurte à de multiples problèmes culturels car elle est conditionnée par la psychologie de l’erreur façonnée depuis la petite enfance. En France, l’erreur (ne pas faire correctement une tâche) a tendance à être assimilée à la faute (commettre un acte immoral), d’où la réduction de la responsabilité à la culpabilité. Cette réduction touche l’erreur elle-même : là où l’erreur contenait sa propre complexité (mélange de positivité et de négativité, genèse à partir de causes directes et de causes indirectes, insertion dans un processus et un système), elle s’appauvrit considérablement en se réduisant à la seule violation d’une règle, d’une procédure ou d’une loi, ce qui exige d’identifier un coupable et de le punir en conséquence.
Tout le problème consiste à valoriser le fait de signaler les erreurs commises alors que le premier réflexe est de les blâmer. Or, la matrice culturelle française oppose de fortes résistances à cette valorisation, comme en témoignent ces extraits des auditions :
« Pour fonctionner, ce système suppose une culture de sécurité active, positive, une culture de non-blâme. »
« Pour appliquer un tel système, il faut avoir le culte de l’erreur dans le sens que l’erreur est humaine et qu’il importe de la détecter. »
« Les Anglo-saxons ont une culture de l’échec différente de celle des Latins et des Asiatiques. »
« La culture latine, voire judéo-chrétienne a pour défaut de ne pas différencier l’erreur de la faute, alors que le fait de commettre des erreurs s’inscrit dans le cours normal des choses. »
« Je fais scandale dans les colloques, lorsque je parle de la nécessité de banaliser l’erreur, voire de la positiver. »
« On peut regretter que le consensus qui existe et qui fonctionne chez les Anglo-saxons, n’existe pas en France. Nous substituons toujours aux relations conventionnelles et de confiance des textes qui encadrent et qui répriment. »
2. L’exemplarité en termes de transparence doit émaner des plus hauts niveaux hiérarchiques.
Nous sommes en France dans un contexte de forte distance hiérarchique où chaque subordonné règle son comportement en fonction de celui de son supérieur. Cette cascade du mimétisme, et par suite de la rivalité, implique un rapport au pouvoir malheureusement souvent déterminé par des enjeux personnels, et non simplement fonctionnels.
La conquête et la préservation de ce pouvoir personnel sont obtenues en développant des comportements parfois contraires à la culture de sécurité, par exemple : réticence à partager l’information, mauvaise coopération avec les pairs, attitudes de complaisance vis-à-vis des supérieurs, absence de remise en question, diffusion d’informations nuisant aux rivaux, promotion de collaborateurs en fonction de leur ralliement et non de leurs compétences, etc.
Dans ce contexte franco-français, la mobilisation des dirigeants pour lutter contre ces travers est primordiale. La moindre défaillance sur ce plan sape la mobilisation des collaborateurs à tous les échelons de l’entreprise. A ce titre, je rappellerai que, suite aux déboires industriels de l’A380 et au comportement suspect des dirigeants qui ont vendu en masse leurs stock options avant l’annonce des retards de livraison, un sondage Gallup a établi que 80% des salariés d’EADS se sentaient démobilisés.
Or, si l’on couple ces travers français au rapport complexé à l’erreur, nous obtenons un système défaillant en termes de culture de sécurité quand la transparence qui est exigée de la part des collaborateurs n’est pas pratiquée par les dirigeants. Voici des extraits des auditions :
« En cas d’incident, tout le monde se demande qui va endosser la responsabilité, qui va prendre les sanctions. La direction ? Ou bien va-t-on mettre cela sur le dos de l’équipage ou des techniciens ? Voilà la cause de l’opacité ! »
« Je suis en train d’enquêter sur un incident récent et je peux vous dire que les événements antérieurs similaires existaient et ne sont pas « sortis » hors d’un petit cercle d’initiés interne à la compagnie. Et cela pour de nombreuses raisons d’ordre culturel. »
« Le problème – c’est pourquoi je disais que c’était d’ordre éthique et culturel -, c’est que les compagnies ne veulent pas rendre compte. Elles ne veulent pas que ces informations soient transmises hors de la compagnie parce que cela ne fait pas bien de dire qu’il y a eu des incidents. »
Le problème de l’anglais
Avec la question du signalement des incidents, la question de la langue anglaise est revenue régulièrement lors des auditions. Au-delà des problèmes de compétences linguistiques, ce sujet mérite de plus amples développements dans la mesure où il fait ressortir des éléments fondamentaux de la matrice culturelle française. D’une part, le rapport à la langue étrangère induit un rapport à la culture véhiculée par cette langue ; d’autre part, il permet d’introduire le problème des compétences non-techniques dont l’importance capitale est souvent négligée dans de nombreux secteurs d’activité en France.
Au préalable, il faut souligner que les Français n’ont pas le monopole des problèmes liés à la langue anglaise. Un pilote britannique aura des difficultés à comprendre l’accent d’un contrôleur aérien du Texas. Mais il y a un rapport à la langue anglaise proprement français, qui génère des difficultés spécifiques. Air France constate ainsi que les cadets néerlandais de KLM ont indiscutablement un meilleur niveau d’anglais que ses propres cadets. Deux éléments sont mis en évidence dans les auditions : d’une part, les déficiences de l’Education nationale en la matière ; d’autre part, les effets pervers de la loi Toubon qui impose le français comme langue de travail. Plus globalement, l’anglais est moins perçu comme une indispensable compétence professionnelle que comme une menace d’invasion linguistique, et donc culturelle. Je vous renvoie ici à mes analyses dans l’article Pourquoi l’anglais n’est pas notre tasse de thé ?
Manifestement, les auditions ont permis de mettre le problème sur la table :
« Les contrôleurs sont des fonctionnaires français ayant parfois du mal à s’exprimer dans la langue de Shakespeare. Quand ils s’adressent à des Américains ou à des équipages parlant anglais comme les Indiens, l’échange risque de tourner court. Il peut y avoir des problèmes de compétence linguistique. »
« L’autre anglais, plus général, qu’on utilise en dehors des procédures classiques, lorsqu’il y a des problèmes, n’est peut-être pas au niveau qu’on pourrait souhaiter chez Air France […] »
« Pour revenir à l’anglais, le problème est que les pilotes parlent un anglais très technique en utilisant toujours les mêmes termes. […] Si les contrôleurs ou d’autres personnels se mettent à parler un peu vite, ils ne comprennent parfois pas bien […] »
« Selon un commentaire récent – peut-être exagéré, mais révélateur d’un problème incontournable -, une bonne partie des pilotes d’Air France resterait au sol si on les obligeait à une pratique parfaite d’une langue qui permet aux aiguilleurs du ciel et aux pilotes de se comprendre lors de toutes les manœuvres. »
Si la place de l’anglais dans le cursus scolaire et dans la société reste très problématique, elle l’est également dans les centres de formation aéronautique. Le fait est que les cours en anglais qui y sont dispensés développent les compétences linguistiques en anglais technique mais restent insuffisants en anglais non-technique, celui « qu’on utilise en dehors des procédures classiques, lorsqu’il y a des problèmes ». Les centres de formation doivent impérativement développer cette approche, ne serait-ce que parce qu’ils sont appelés à recevoir de plus en plus d’élèves étrangers. Or, pour qu’il y ait des interactions et des synergies entre Français et étrangers, on ne peut évidemment pas s’en tenir à une communication technique.
Sur ce plan, l’ENAC est tiraillée entre deux impératifs : d’une part, la nécessité de se conformer à la loi Toubon et de maintenir le français comme langue de référence ; d’autre part, la nécessité de suivre le mouvement d’internationalisation des formations et des recrutements. Sur le premier aspect, on peut lire l’affirmation suivante sur le site de l’ENAC : « En dehors de formations entièrement dispensées en anglais, la principale langue d’enseignement à l’ ENAC reste le français. » Suit alors cette précision : « C’est pourquoi chaque année de nombreux étudiants en échange apprennent notre langue de manière à suivre les cours plus facilement. » Autrement dit, les étrangers ne peuvent intégrer l’ENAC que dans la mesure où ils maîtrisent le français.
Autant dire que cette exigence limite l’attractivité de l’ENAC auprès des jeunes talents étrangers. Il est donc impératif de proposer des formations en anglais, d’autant plus que les pilotes français auront de plus en plus affaire à des équipages multiculturels. Loi Toubon ou pas, l’anglais est appelé à devenir la langue de référence sur de nombreux vols.
Mais l’ENAC se heurte alors à la réticence des élèves eux-mêmes et au manque de compétence linguistique des formateurs. Ainsi, le 13 juillet 2010 s’est tenue une réunion protocolaire sur la stratégie de l’ENAC par rapport aux mutations du monde de l’enseignement et de la navigation aérienne. Le directeur de l’ENAC a fait part des problèmes rencontrés pour mettre en place la formation en anglais des contrôleurs aériens (ATCO) : « Par exemple pour la formation ATCO en anglais nous avons eu des difficultés : nous avons eu peu de volontaires, et sur ce vivier, peu de gens capables de faire les cours en anglais. » (source ici, en pdf)
La myopie des compétences techniques
Plus globalement, l’aéronautique en France se confronte à la difficulté, voire à la réticence, à développer une approche décomplexée et professionnelle des facteurs humains. Ce n’est pas là une défaillance spécifique du secteur aérien mais, plus profondément, une caractéristique de la matrice même de la culture française. Nous retrouvons les mêmes difficultés dans d’autres secteurs, par exemple dans le secteur médical et le milieu hospitalier, et en règle générale dans tous les secteurs à forte technicité.
La valorisation extrême de la toute-puissance de la technique engendre un excès de confiance dans cette dernière, et par conséquent une dévalorisation – sinon une négligence – des facteurs humains perçus comme des facteurs de perturbation et d’instabilité. La culture commune de la technique est supposée soumettre les contingences humaines à un ordre supérieur, rationnel et universel. Cette vision idéale ne cadre ni avec les singularités psychologiques ni avec les particularismes culturels de chacun (voir sur ce point l’article précédent Le refoulé interculturel dans l’aéronautique).
Or, les compétences techniques et les compétences dites non-techniques sont comme l’avers et le revers d’une même médaille. En se focalisant uniquement sur les premières et en négligeant ou sous-estimant les secondes, ce ne sont pas 50% des capacités qui restent atrophiées mais 100% dans la mesure où les compétences techniques sans le savoir-faire humain virent à l’incompétence. Rappelons que les facteurs humains arrivent en tête parmi les causes des incidents, quasi-accidents et accidents.
Il est donc tout à fait préjudiciable que la performance technique génère une myopie au sujet de l’environnement non-technique. Cette myopie crée l’illusion d’un éloignement du non-technique sur le mode du « ça ne nous concerne pas » alors même que rien n’est plus proche et intime que le facteur humain. Par suite, face à un événement critique, l’analyse va se focaliser sur les causes directes et risque de renvoyer les causes indirectes à l’arrière-plan. C’est ainsi qu’on aura tendance à prendre des mesures spectaculaires pour remédier à une défaillance (identifier et punir le coupable, définir de nouvelles procédures, émettre des recommandations, rappeler les grands principes, etc.) alors que le plus urgent tient souvent à des mesures discrètes (revoir le ratio vol en simulateur/vol réel, diversifier les profils recrutés, développer la formation aux facteurs humains, créer des liens entre anciens et cadets, etc.). Mais de ces mesures qui se déploient sur le long terme, nul ne peut en revendiquer immédiatement les effets bénéfiques pour sa gloire ou son prestige personnels…
Je prendrai deux exemples évoqués lors des auditions pour illustrer cette difficulté à intégrer les causes indirectes dans les préoccupations liées à la sécurité : la question de la consommation d’alcool et la gestion de la fatigue.
Exemple 1 : la consommation d’alcool
Conformément à la réglementation, les pilotes ne doivent pas boire d’alcool dans les huit heures qui précèdent leur prise de fonction. La question se pose cependant de savoir quel est le taux d’alcoolémie autorisé pour les pilotes. Or, contrairement au transport routier pour lequel un taux est strictement fixé par la loi, il n’y avait en 2004 rien de semblable pour le transport aérien. Il n’y a donc pas non plus de contrôle inopiné.
Les autorités, les compagnies aériennes et les syndicats n’avaient jamais réussi à se mettre d’accord sur la définition d’un taux d’alcoolémie pour les pilotes, et l’une des raisons de cet échec tenait au fait que l’alcool ne faisait pas partie de l’horizon visible des causes directes d’accident :
« Chaque fois que nous avons voulu aborder le sujet, il y a eu blocage. C’est ainsi qu’aujourd’hui, on n’a toujours pas pu fixer de taux. »
« L’alcool n’apparaît pas comme un facteur contributif d’accident dans les études actuelles sur la sécurité du transport aérien, contrairement à la route. »
Comme pour le rapport à l’erreur, deux autres facteurs culturels interviennent dans ce blocage : l’idée de culpabilisation et un excès de confiance, au détriment de la recherche d’une solution pragmatique :
« Il y a aussi le sentiment de la profession d’être mis à l’index et en accusation. Cela a été peut-être plus facile pour la route parce que la réglementation concernait tout le monde. Mon sentiment est que la profession s’est sentie mise en accusation, présentée comme une profession particulièrement dangereuse qu’il fallait réglementer, alors que d’autres professions tout aussi dangereuses ne le sont pas. »
« Pour ma part, je fais confiance à mes camarades pilotes ou personnels navigants commerciaux pour s’imposer une éthique qui leur permettra d’assurer cela. »
Notons enfin que si la France n’a jamais réussi à imposer un taux d’alcoolémie, la législation en la matière a en fait évolué en juillet 2010 quand l’Union européenne a imposé un taux maximal de 0,2 gramme à la prise d’activité.
Exemple 2 : la gestion de la fatigue
En attendant, il est particulièrement intéressant de constater que la gestion de la fatigue se heurte elle aussi à l’idée qu’il ne s’agit pas là d’une contribution directe à la réduction des risques. Or, il s’agit là d’une perception culturellement marquée. D’autres pays ont une approche plus professionnelle de la gestion de la fatigue. Je reviendrai sur les facteurs culturels liés à la gestion de la fatigue dans le prochain article de cette série, qui sera consacré aux risques interculturels dans l’aéronautique. En attendant, voici deux extraits des auditions sur ce sujet :
« Dès lors, pourquoi ne parvient-on pas à faire évoluer la réglementation et la sécurité ? Parce qu’il n’y a pas une relation directe de cause à effet entre un pilote fatigué et un pilote qui mettra en danger la sécurité du vol. »
« Lorsque l’on pense « fatigue », on pense « dette de sommeil ». La dette de sommeil entraîne une augmentation des temps de réponse, de petites omissions. Sur des temps de réaction, des tests élémentaires, on constatera des dégradations. Par contre, sur une performance opérationnelle globale, c’est beaucoup plus difficile à démontrer. »
Des facteurs humains aux facteurs culturels
L’approche des facteurs humains dans l’aéronautique en France est loin d’être décomplexée, performante et professionnelle. Dans certains cas, nous ne sommes pas loin du déni. Depuis les auditions de 2004, certains progrès ont été réalisés, notamment dans le développement de formations aux facteurs humains et la multiplication de cours en anglais. Mais ces avancées restent embryonnaires du fait de l’extrême suffisance inspirée par la valorisation exclusive des compétences techniques. Celles-ci ne suffisent pas, elles s’anéantissent même, si elles n’intègrent pas les compétences non-techniques comme une dimension essentielle de l’activité.
Si les facteurs humains restent atrophiés dans le secteur aérien, qu’en est-il alors des facteurs culturels ? Et plus, précisément, des facteurs interculturels ? Est-on conscient de nos propres réflexes culturels français et de leur impact lors de nos interactions avec d’autres nationalités ? Une réflexion est-elle en œuvre de façon à ce que les opportunités de coopération interculturelle ne se transforment pas en risques ? Sait-on par exemple intégrer les cadets étrangers dans nos centres de formation en France ? Forme-t-on les PNC et les PNT à la gestion des différences culturelles qui peuvent exister entre eux, qui sont propres aux passagers, aux contrôleurs aériens, aux mécaniciens ?
De façon générale, se prépare-t-on à l’internationalisation croissante des compagnies aériennes et des équipages ? Quelles grilles d’analyse, quels outils, quelles méthodologies, quels programmes de formation en matière de management interculturel doit-on mettre en place dans ce secteur spécifique ?
Ces questions seront abordées dans les articles suivants, et notamment dans le prochain intitulé Sécurité aéronautique et risques interculturels.
Benjamin PELLETIER